![]() Janvier 2016
Janvier 2016
Préface du livre d’art « Algériennes, source du futur »
rédigé par Rachid Boudjedra
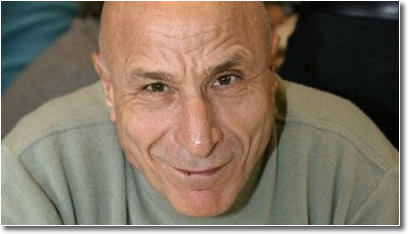
Farid Benyaa ou les sens inversés
A regarder ces toiles de Farid Benyaa on a l’impression de découvrir l’opulence des êtres et des objets, leur insolence aussi. Les formes ici échancrent le support et ressourcent une sorte d’érotisme suave, c’est-à-dire ce rebord glissant du néant. Tous les visages de femmes dont la beauté écorche la toile, sortent du cadre et nous sautent au visage pour étaler une sorte de vie vive et vivace, l’étaler et en faire un argument de l’intelligence.
Il y a dans cet art de Benyaa une sensibilité et une émotivité émouvante et touchante parce qu’elle est d’une sincérité totale. Dépassement donc de l’esprit au corps, renversement paradoxal de l’anthropologie et de l’exotisme, et incarnation charnelle qui institue et restitue une occasion et un temps démesurés pour déployer librement la sensualité, voire la jouissance dont l’un des versants, peut-être le plus essentiel, demeure métaphysique. Une jouissance puisée au fond des temps, au fond des millénaires algériens jalonnés de haltes esthétique qui permettent aux femmes touareg, berbères et arabes de se refaire une beauté de rajouter un grain de beauté ; un arc peint au-dessus des sourcils déjà charbonneux, comme l’ombre d’une halte, le désordre d’un bivouac bédouin.
Ces visages d’hommes et de femmes, ces signes où l’encre coule et découle de l’expression qui fulgure la toile, la cadastre avec des morceaux de notre patrimoine vestimentaire et ornemental. Une jouissance qui sourd de ces yeux immenses, de ces khôls aux muances variés, de ces bijoux enjolivant les femmes et qui forment comme un catalogue de la richesse de nos arts manuels. Car chaque membre, chaque coin de peau, chaque cil a le sien. Une variété incommensurable qui a la qualité et le pouvoir de diffuser cette jouissance qui s’affole et s’érotise dans l’immédiateté nourrie par les traces d’un passé magnifique et mirifique de la femme algérienne.
Passé certes fragile, lézardé de razzias, d’invasions coloniales et de guerres interminables, mais qui pose la permanence d’un pays entêté et qui met en déroute ses assaillants, peut-être, éberlués par tant de beauté des terres, des cieux, des mers et… des femmes. Passé, certes pelucheux, poreux et donc fragile d’une histoire, peut-être pudique, peut-être enfouie parce que la douleur est là, à fleur de peau et qu’efface – très vite – la jubilation de ces visages, de ces fragments de corps qui résument la résistance nationale et la fougue de la passion de vivre et de rendre le réel inoffensif, voire festif. Car les tableaux de Farid Benyaa
sont un des échos entremêlés de nos déserts, de nos montagnes et de nos médinas et qui créent une sourdine synchrone à la Boulez ou à la Shönberg, doublée par gouttes d’une snitra virtuose entre les mains d’El Anka, comme des gouttelettes de sueur que les femmes targuies savent sécher avec une alchimie indicible.
Puis ses traces à l’encre de chine qui forment des méandres, comme un tracé dessiné sur un palimpseste qui jaillit et s’estompe au fil du temps. Traces d’érudition, de ravissement et de mémoire millénaire qui tintinnabulent dans nos têtes et dans nos consciences et qui se régénèrent grâce à des artistes talentueux et généreux, tel Farid Benyaa. Mémoire millénaire, donc surgie de ces immenses toiles et de ces bouts de tableaux miniaturisés, tenace à la fois et pulpeuse, pelucheuse, hargneuse et charnelle, en même temps.
Ravissement aussi, devant les réalités d’un éros furtif, fuyant, presque maladroit mais dont la maladresse ravive les sens et mène à l’extase soufiste d’un Ibn Arabi fabulateur d’un cosmos vertigineux. Ici, on a une sorte d’inventaire minutieux à la fois et désordonné qui s’approprie le chaos dans le sens platonicien du terme. Cet « inventaire » de Farid Benyaa permet de tracer le signe, signaler le geste, proférer le rituel ancestral d’une splendeur jamais disparue malgré les désastres de l’Histoire que la beauté de ces femmes (et de ces hommes) efface. Palimpseste aussi d’une écriture énigmatique où le peintre calligraphie, incise les lettres arabes et tifinagh dans les formes de ses personnages fabuleux car l’art, en général, et la peinture en particulier tentent de fracturer les éléments savonneux d’un réel somme toute comateux, insaisissable, instable et mystique. Cotonneux ! Soyeux ! En un mot, non pas invisible mais inaudible parce que trop émouvant et trop ému, à la fois.
Jean Sénac écrivait en 1966 : « La première mie du mot (une écriture de sexe d’opale, miellée flamboyante… une écriture et son précipice alternent les vingt-six plaies du vocabulaire.) Une écriture de bleu d’épaule, de toison brune, d’un sourcil charbonneux où la sueur et la salive ont délavé la pure audace du poète, du peintre ; ceux du premier mot, du premier signe de toile, comme une menace de paix. (In AVANT CORPS) ».
Les toiles de Farid Benyaa étoffent le cadre qui déborde parfois le centre et se trouve – parfois – débordé en tant que périphérie essentielle et portant l’empreinte digitale de la tribu (Des tribus !) sans une once d’exotisme ou de tape à l’œil ou de folklorisme accrocheurs parce que ces toiles, ces peintures, ces dessins et ces enluminures du rebord des êtres et des choses vont chercher leurs racines dans le gouffre effrayant de la nostalgie d’un passé fabuleux et du désir d’un retour à l’enfance innocente.
Bouts de tapis, de kilims et – surtout – de robes et de kaftans ; de coiffes et de turbans coniques et bariolés, velours garance ou bordeaux ; taffetas violets ou mascara, qui transcendent l’espace, le galvanisent et le taraudent jusqu’à ce que, de périphérique, il devienne central. Nodal. Tel que le point au-dessus du „noun“ écartelé, lové et écarquillé. Qui devient le nombril (deviné, suggéré), l’œil, le joint solaire d’où jaillit toute la luminosité. Tatouages (grandiloquent et fusionnel à même la peau ample et vaste). Broderie. Bijoux comme incisés aussi à même la peau avec cette nomenclature interminable que nos ancêtres ont déployé pour dire leur amour et leur reconnaissance pour les femmes de leur pays. Le tout transcendé – paradoxalement – par l’éphémère, le silence, le fragile, le criard et le pathétique ; surtout lorsque les calligraphies qui énoncent
toutes les lettres femelles de l’alphabet arabe selon la conception d’Ibn Arabi dans « Les éclats de la sagesse » ; satinent le palimpseste en vieux papyrus quelque peu frivole, quelque peu rigide, à cause – peut-être, de ce trait noir et encreux qui fracasse la toile de Farid Benyaa qui crée une sorte de destin coincé entre le désastre de la vie et la jubilation du monde.
Tous ces visages, donc, maquillés, peinturlurés et superbes donnent l’impression au « voyeur » que tous les sismographes se sont emballés à cause de cette éruption permanente de traits coloriés, de coloris et d’encres, cinglants la toile et son cadre de graphiques abstraits et encreux, voire résineux. Et dans certaines teintes ou nuances du gris, il y a comme des traces d’ecchymoses entre le bleu Mascara et le blanc du carbure qui ont illuminé notre enfance avec ses lampes phosphorescentes et mettant de la gaité dans nos vieilles maisons ancestrales. Dans les gravures, il y a des rouilles (les chevaux arabes et authentiques), des marrons et des bruns qui constituent à eux seuls, toute une métallurgie de chambres closes, de paravents enluminés, de visages resplendissants et parfois schizophrènes d’autres fois. Pathétiques. Muets. Pour dire, aussi, le sort de la femme algérienne et son courage à affronter ce mauvais sort, ce statut difficile et affligeant. Ici se fige la géographie de ces vastes corps plus secrets, sortes de mirages aux bariolages incroyables qui fixent la toile à travers le dédale de l’imaginaire vrai et du réel faux ou faussé par les hommes pour améliorer leur destin, leur malédiction ! Même.
Et cette authenticité sincère et cette « naïveté » prodigieuse qui frappe dans l’œuvre gigantesque de Farid Benyaa, avec son savoir-faire immense et son savoir-vivre talentueux et élégant. Un talent et une élégance fascinés par leur propre avenir, leur propre pulsion dans l’interminable, l’indéterminé et l’universel qui déborde sur le cosmique et le cosmogonique comme si Farid Benyaa voulait nous mettre dans l’avenir du temps avec une nostalgie douloureuse pour le temps passé jamais retrouvé, jamais assouvi parce que – en fin de compte – utopique et poétique.
Ibn Hamdis, poète du XI° siècle disait des peintres « qu’ils plongent leurs pinceaux dans le soleil pour nous donner de l’émerveillement ». Farid Benyaa secrète l’extase et le bonheur (teinté d’une certaine amertume) comme les vers secrètent la soie au détriment de leur propre vie.
Car peindre, c’est mourir beaucoup et Farid Benyaa est le survivant fabuleux de sa propre légende.
Alger, janvier 2016


